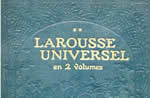Histoire

D'après les dessins de M. Longa.
Les Landes
Il existe, à l'une des extrémités de la France, un pays exceptionnel, pays aussi singulier par son aspect que par les mœurs des populations qui l'habitent, pays plus inconnu pour la plupart d'entre nous que les crêtes des Apennins ou les déserts de la Thébaïde ; ce sont les Landes. L'insouciance dont cette contrée est généralement l'objet vient sans doute de ce qu'elle est trop près de nous. Placée à quelques centaines de lieues au delà des Pyrénées, elle eût attiré les regards curieux. C'est que le voyageur aime à revenir de loin ; il sait que ses récits, comme les bâtons flottants de la fable, ont besoin d'être vus à distance. Il est rare, d'ailleurs, qu'il n'ait pas à raconter quelques miracles, qu'un examen trop facile pourrait effaroucher, et il connaît le proverbe qui s'attache à son nom.
Ce n'est pas que les Landes n'aient aussi fourni le thème de bien des fables ; nous pourrions en citer, et des plus ridicules. Mais nous aimons mieux en épargner l'ennui aux lecteurs de l'Illustration, et opposer aux récits, presque tous erronés, qui ont été faits jusqu'à ce jour, une description sincère, qui, à défaut du prestige du langage et de l'intérêt de la narration, aura du moins le mérite assez rare d'une scrupuleuse fidélité.
Le pays que nous avons l'intention de faire connaître est cette immense plaine qui, des bords de l'Océan, s'étendant aux rives de l'Adour et de la Garonne, a donné son nom au département dont elle forme la majeure partie. On le désigne sous le nom générique de Landes ; mais il comprend trois grandes fractions, les Petites et les Grandes Landes, et le Maransin, qui, malgré quelques différences dans les mœurs et l'aspect, forment un tout pour ainsi dire homogène.
Sur la rive opposé de L'Adour et dans le même département, s'étendent des plaines comparables à ce que la France possède de plus fertile, et coupées par de longues files de coteaux, derniers chaînons des Pyrénées. C'est la Chalosse.
Bien que des champs et des prairies étendent çà et là leurs nappes de verdure, bien que des maisons s'accroupissent silencieuses et isolées à l'ombre des vieux chênes, les landes et les pins dominent tellement la physionomie générale du pays, qu'ils appellent tout d'abord l'attention du voyageur, et font naître dans son esprit une de ces associations d'idées dont l'empreinte est ineffaçable. Les landes nous occuperont donc d'abord.
Ces vastes solitudes, qui donnèrent leur nom au pays qu'elles couvrent en partie, ces larges plaines tapissées de bruyère à la fleur rose, à la tige sèche et ligneuse, ont toujours été en possession de jeter dans un étonnement empreint de je ne sais quelle teinte de tristesse l'esprit de celui qui les aperçoit pour la première fois.
 |
Si le hasard portait vos pas jusque dans les bruyères de Labouheyre ou de Commensac, vous y verriez, perchés sur leurs hautes échasses, ces bergers dont on a fait la personnification du pays. De mensongères relations ont rendu désormais inséparables les idées d'échasses et de Landais. D'après l'opinion généralement répandue, l'échasse est au Landais ce que la botte est au Parisien ; c'est sur ses échasses qu'il passe sa vie ; un Landais sans échasses est un être incomplet. Chacun a vu les échassiers, même dans les lieux où il n'en a jamais paru un seul. Un écrivain célèbre, parcourant naguère la route qui longe ces contrées, a daigné apercevoir (par quel moyen, nous l'ignorons) ces échassiers fameux dont dix lieues au moins le séparaient. Il en est ainsi de tous les autres, et nous ne craindrions pas d'affirmer que de tous ceux qui les ont décrits, il n'en est pas un seul qui les ait vus.
Trois localités à peine, placées au milieu des Grandes Landes, loin de toute communication et des grandes routes jusqu'à ce jour suivies par les voyageurs, conservent, depuis un temps immémorial, l'usage de ce genre de locomotion.
Élevé à huit ou dix pieds au-dessus du sol, l'échassier peut défier le trot du cheval, et a longtemps remplacé, avec avantage de vitesse, les coursiers de l'administration des postes. Mais l'usage des échasses est aujourd'hui exclusivement réservé au berger de ces contrées, auquel le rendent indispensable, comme moyen de prompte et facile locomotion, la hauteur des bruyères, les marais, le nombre des bêtes confiées à ses soins, et la nécessité de se défendre des loups.
Le berger landais est à demi nomade ; il erre le plus souvent à la suite de son troupeau, campe chaque nuit dans l'une des cabanes, nommées parcs, dont la Lande est parsemée, et ne rentre dans sa famille, durant l'été du moins, que pour y renouveler périodiquement ses provisions. Les troupeaux de ces contrées, plus remarquables par le nombre que par la qualité des bêtes qui les composent, fournissent cependant au commerce une viande estimée et une laine qui atteint partiellement un grand degré de finesse.
Hospitalier et officieux, le berger landais, malgré ses habitudes sobres et forcément silencieuses, est d'une humeur assez gaie et charme quelquefois les ennuis de l'isolement par de petites rondes qu'il improvise au besoin et qui ne manque pas d'une certaine grâce rustique et toute originale.
| Le pin est un arbre triste ; son feuillage allongé en aiguilles, d'un vert presque noir, qu'il ne dépouille jamais, lui donne un aspect sévère. Les anciens l'avaient pris pour emblème des sombres pensées, et le plaçaient sur les tombeaux avec le saule et le cyprès. Le pin vient naturellement dans tous les lieux protégés contre l'approche des troupeaux. Mais pour l'obtenir plus droit et plus fort, on le sème ; et alors il atteint des dimensions et une beauté de formes auxquelles le pin bâtard ne peut jamais parvenir. Dans les premiers temps, l'espace ensemencé ressemble assez à un champ où les céréales commencent à poindre ; mais plus tard, s'élève une masse épaisse, compacte et impénétrable à la lumière même. C'est à peine si l'écureuil peut y trouver l'espace nécessaire à son nid de feuilles entrelacées, et l'homme ne le traverse que par des chemins qu'on pourrait croire creusés dans des blocs de granit vert. Mais à mesure qu'il grandit, les rangs se font sensiblement moins épais, la hache vient donner aux rejetons conservés l'espace que leur développement réclame, et lorsque, parvenus à toute leur hauteur, ils sont en plein rapport, une moyenne de plus d'un mètre les sépare. Alors les tiges, droites comme celles du peuplier d'Italie, sont entièrement dépouillées de leurs branches, à l'exception du sommet, ceint d'une touffe toujours verte comme d'un diadème impérissable. Dans les temps où le vent souffle avec violence, toutes ces têtes qui se touchent, et ne paraissent faire qu'une mer de verdure, se balancent lentement avec un murmure prolongé qui rappelle le mugissement des flots à l'approche de la tempête. Mais dans les moments de calme, lorsque la cigale salue de son chant grêle et criard le soleil dont la chaude lumière inonde la forêt, vous croyez voir plutôt un entablement sans fin, soutenu par les innombrables colonnes de temples et de palais ruinés ; et si, dans le même instant, débouchent de la plaine des cavaliers enveloppés dans leurs capes de laine blanche, au capuchon pointu, en tout semblables au burnous des Arabes, votre pensée, malgré vous, se reporte aux rives de l'Orient, et vous vous surprenez rêvant des nomades habitants du désert et des lieux où s'éleva jadis la ville du soleil, Palmyre aux mille colonnes ! |
Les Landes doivent à la culture du pin l'un de leurs revenus les plus considérables.
Le premier éclaircissage produit les minces échalas destinés à soutenir les vignes ; on en tire ensuite des lattes pour les toitures, et enfin des solives et des planches. Cette dernière partie fait l'objet d'un commerce fort étendu.
| Mais le principal produit du pin, c'est la substance résineuse qu'il fournit ; revenu permanent, à peu près sûr, et que les vents de l'est peuvent à peine contrarier. L'opération par laquelle ce produit est obtenu porte le nom de taille. Régulièrement, elle ne devrait pas commencer avent que le pin n'eût atteint l'âge de vingt-cinq ans ; mais cette règle n'est malheureusement pas toujours observée. L'entaille destinée à donner passage à la sève se nomme carre. Commencée au ras de terre, elle se continue en montant toujours sur une largeur uniforme de 4 à 5 pouces, en sorte qu'à la septième année, elle atteint 12 ou 14 pieds d'élévation. Pour tailler à cette hauteur, le résinier emploie une échelle d'une forme tout primitive, et dont l'habitude seule peut lui permettre de tirer quelque parti, c'est une perche où des coches taillées en cul-de-lampe s'élèvent jusqu'à 8 ou 10 pieds. Le résinier applique l'extrémité supérieure de cette perche, non sur l'arbre, mais à côté, monte de coche en coche, et, appuyant son échelle contre le tronc avec le genou gauche, tandis que le pied droit fait contrefort sur le pin, il taille de sa petite hache avec tout autant de facilité que s'il était à terre. |
La résine qui s'échappe de la carre se divise en deux espèces : le barras et la gemme ; celle-ci, la plus précieuse de beaucoup, doit sans doute son nom latin aux gouttelettes qu'elle forme et qui ressemblent à autant de perles ou des pierres précieuses ; elle coule lentement dans un petit réservoir pratiqué au pied de l'arbre, et qu'on vide plusieurs fois chaque année.
| Le barras, au contraire, blanc et opaque, se colle à la carre, qu'il finit par recouvrir d'une couche pareille au sucre candi. La récolte se fait en automne. Ces deux produits du pin, connus sous la dénomination générale de résine, et traitée dans les fabriques du pays, donnent l'essence de térébenthine, le brais, le goudron, et enfin la colophane. Les ateliers à résine sont construits d'après divers systèmes ; le dessin que nous donnons ici représente le plus ancien et le plus répandu de tous. Des systèmes nouveaux, et de beaucoup supérieurs, ont donné des produits comparables au moins à ceux importés du Nord et des Etats-Unis. C'est à la vapeur, ce moteur universel, qu'est dû un perfectionnement, dont nous ne doutons pas de voir bientôt les effets appréciés à leur juste valeur par tous les fabriquants de la contrée. Quand il n'est pas débité en planches ou en madriers, quand il ne fournit pas au chauffage un élément justement dédaigné, vu l'abondance d'autres essences plus propres à cet usage domestique, le pin, transformé en charbon, alimente les usines assez nombreuses répandues dans le pays, des verreries, des martinets, et quelques hauts-fourneaux. Parmi ces derniers, on en remarque trois surtout, situés dans les Grandes Landes, et dus à la persévérance et à l'habileté d'un industriel aujourd'hui haut placé et justement honoré dans le pays. |
Les divers produits du pin, les céréales, les vins et la laine forment les objets les plus ordinaires du commerce des Landes. La cire et le miel ont aussi donné naissance à une industrie assez répandue. Des milliers de ruches s'étendent au milieu des bruyères ; car c'est surtout dans les pistils de ces plantes que les abeilles vont puiser les éléments d'un miel transparent et hautement savoureux, qui ne le cède en réputation qu'à celui de Narbonne.
Les landes et les pins ne se partagent pas seuls toute l'étendue du pays. Des bosquets de chênes, de l'espèce appelée tauzin, viennent d'espace en espace faire une diversion désirée. Soumis à un émondage périodique, les tauzins n'étendent guère au-dessus de trois ou quatre mètres leur tige rugueuse et bosselée, dont la cime, beaucoup plus grosse que le tronc, leur donne un aspect fantastique d'une armée de géants. La tauziole, au contraire, élève jusqu'au ciel une tige extrêmement droite, et presque dépourvue de branches ; le liège semble se draper dans son feuillage d'un vert impérissable ; le long des ruisseaux, les aunes forment d'impénétrables massifs, et les ormeaux se suspendent aux bords des précipices.
Illustration, 24 avril 1847